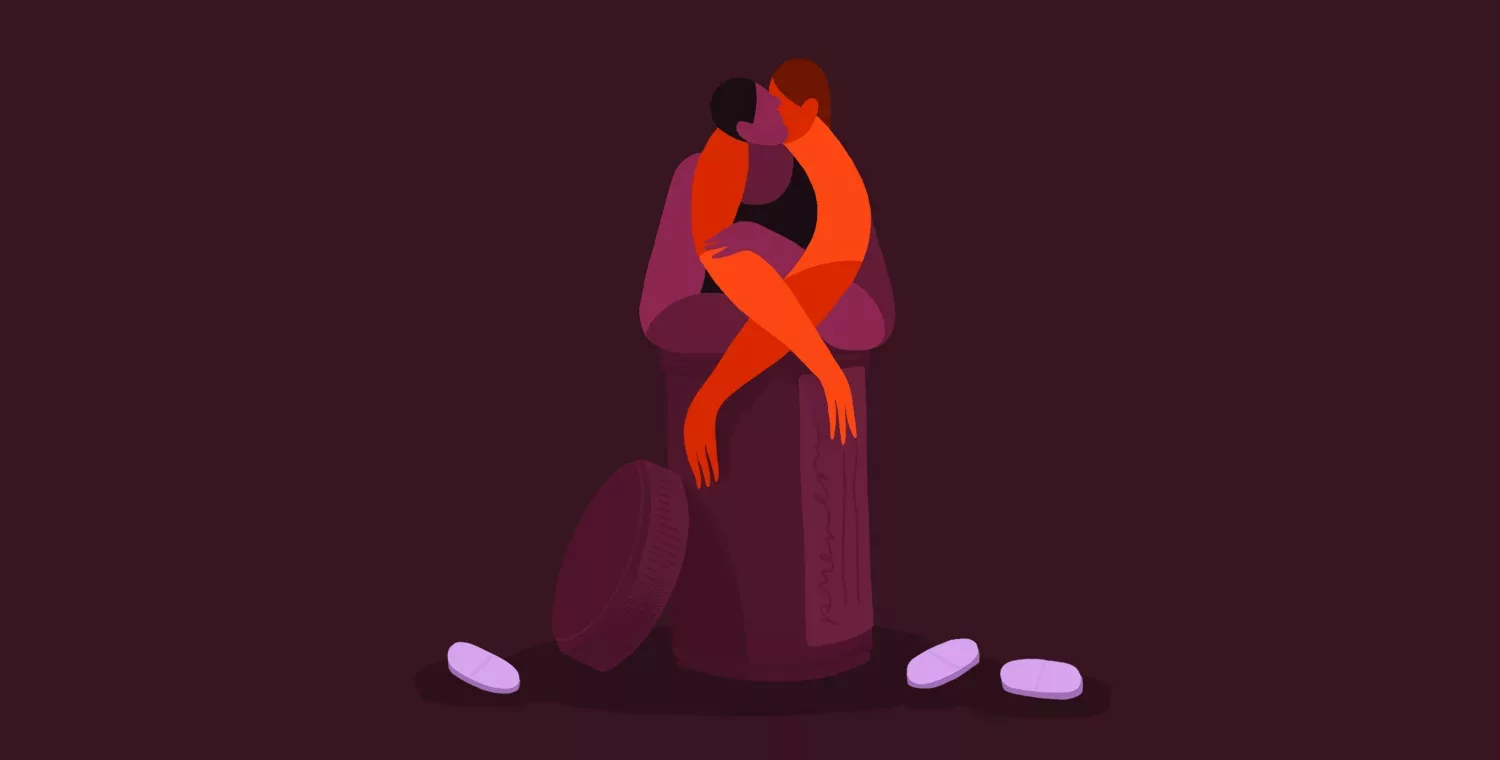Your cart is currently empty!
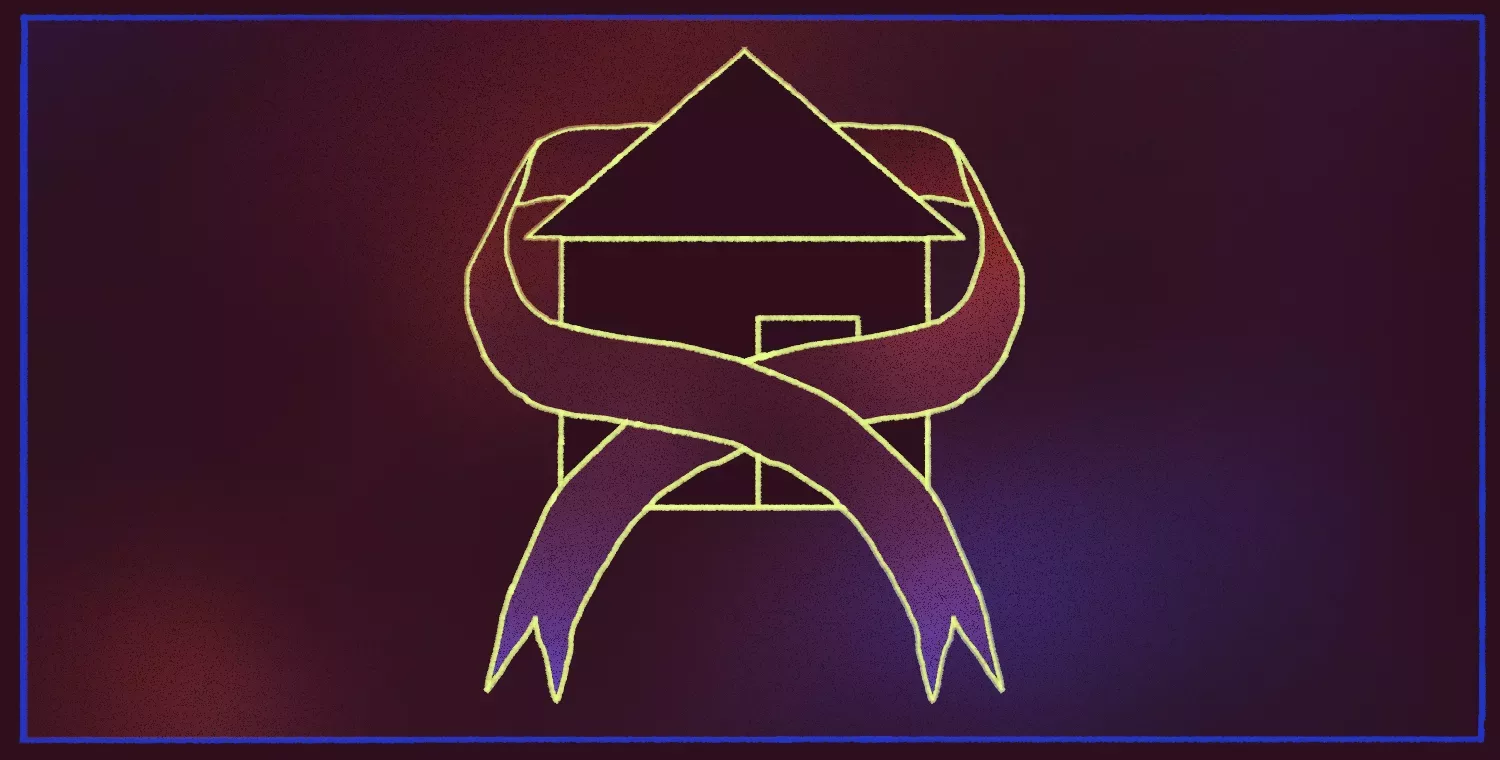
Autotest du VIH : comment analyser sa goutte de sang à la maison?

Cet article est présenté par COCQ-SIDA, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida.
En novembre 2020, l’autotest du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) voit le jour au Canada, un important moment pour l’accessibilité au dépistage du VIH qui se faisait jusque-là exclusivement en clinique. J’ai discuté de celui-ci avec trois membres de l’équipe de la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) : Martine Fortin, coordonnatrice de projets, Tanguy Hedrich, coordonnateur à la recherche communautaire et Ken Monteith, directeur général.
« L’un des plus grands avantages de l’autotest est sa confidentialité et l’indépendance qu’il offre aux personnes qui peuvent désormais choisir le moment auquel elles veulent se faire dépister », explique d’emblée Martine.
Notons que pour plusieurs, le simple fait de devoir se déplacer en clinique et de devoir interagir avec le personnel médical constitue un important frein au dépistage.
Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour que le test soit disponible au pays de la feuille d’érable alors que nos voisins du Sud, eux, en ont différentes versions depuis plusieurs années? C’est simple : au Canada, avant qu’un produit de santé puisse être commercialisé, il faut d’abord que Santé Canada l’approuve, aux frais des compagnies pharmaceutiques. De par sa petite population, le Canada n’est pas considéré comme un important marché pour l’autotest. Le milieu communautaire s’est longtemps battu pour convaincre les entreprises à commercialiser l’autotest du VIH.
« Commercialiser l’autotest au Canada devenait décourageant pour les entreprises qui devaient investir beaucoup pour peu de retours », explique Ken, qui se voit soulagé que tous les efforts déployés pour en arriver à ce jour aient finalement porté fruit.
Au moment d’écrire ces lignes, le seul autotest offert à la population canadienne est celui de l’analyse de goutte de sang. Le groupe national de recherche REACH Nexus effectue des essais cliniques pour que l’autotest VIH par voie orale puisse être distribué au Canada d’ici la fin 2022 ou le début 2023. (On leur envoie toute notre admiration et notre soutien!)
Comment fonctionne l’autotest du VIH?
Une fois la barrière de l’accessibilité surmontée, on réalise vite que le test est assez simple à utiliser, voire même plus facile que celui de la COVID. Chaque trousse arrive avec un livret d’instructions illustrées. D’autres outils, comme la vidéo ci-dessous, permettent de comprendre chacune des étapes. Il est également possible d’avoir du soutien du milieu communautaire qui ne peut cependant pas effectuer le test (lire : piquer le doigt) à votre place.
« Au Québec, le dépistage est considéré comme un acte médical et donc, seul le personnel soignant peut piquer le doigt de quelqu’un d’autre. Les intervenant·e·s communautaires peuvent apporter un soutien moral, mais ils et elles ne peuvent [administrer] le test », raconte Ken. Il ajoute que l’autotest est une bonne solution, car la loi n’interdit à personne de piquer son propre doigt.
Concrètement, l’autotest s’effectue en sept étapes :
- Se laver et se sécher les mains;
- Se piquer le bout du doigt pour en faire sortir une goutte de sang (cette étape est sans doute la plus complexe. On recommande d’ailleurs de se réchauffer les doigts ou d’émettre une pression sur son doigt pour faciliter le tout!);
- Déposer une goutte de sang dans le premier flacon (la bouteille rouge) en s’assurant que son doigt ne touche pas à celui-ci au passage;
- Fermer le flacon avec le bouchon, l’agiter et verser son contenu dans le récipient prévu à cet effet, et attendre quelques secondes pour que le liquide disparaisse;
- Prendre le deuxième flacon (la bouteille bleue) et l’agiter. Verser son contenu dans le récipient (le même que dans la précédente étape), et attendre quelques secondes pour que le liquide disparaisse;
- Prendre le troisième flacon (la bouteille grise) et l’agiter. Verser son contenu dans le récipient (le même que dans les deux précédentes étapes), et attendre quelques secondes pour que le liquide disparaisse;
- Attendre son résultat qui apparaîtra en une minute à peine. Soixante secondes, top chrono!
Notons que l’autotest détecte l’infection trois à douze semaines après l’exposition. C’est ce qu’on appelle la période fenêtre.
Comment peut-on se procurer un autotest du VIH par analyse de goutte de sang?
C’est l’accessibilité qui s’avère être le talon d’Achille de l’autotest du VIH. À l’heure actuelle, il n’est disponible qu’en ligne sur le site web du Laboratoire BioLytical, soit l’entreprise de biotechnologie qui produit le test. Il faut prévoir 57 $ pour un test ou 85 $ pour deux, incluant les taxes et la livraison.
On peut aussi se procurer gratuitement une trousse de dépistage grâce au programme de recherche « J’agis pour savoir ». Pour participer à la recherche, il suffit de suivre ces étapes :
- Télécharger l’application mobile « J’agis – Je me dépiste »;
- Consentir à la recherche, se créer un profil et répondre à un sondage;
- Se faire livrer jusqu’à trois trousses d’autodépistage à la maison (ou chez un organisme partenaire);
- Effectuer le test en suivant les indications sur l’application;
- Enregistrer son résultat de manière anonyme.
Les personnes qui participent à la recherche peuvent non seulement obtenir un test gratuitement, mais en plus, elles contribuent à la lutte contre le VIH au Canada. Raison de plus pour choisir cette option!
« Il est évident que ce n’est pas avec un test à 57 $ qu’on va réussir à rejoindre les populations marginalisées. Cependant, le programme “J’agis pour savoir” nous permettra de justifier nos demandes de subventions gouvernementales et ultimement, ce qu’on souhaite, c’est que le système de santé assume, en totalité ou en partie, les coûts et la distribution de l’autotest partout au Canada », explique Tanguy.
Grâce à l’étude en cours de REACH Nexus, plus de 12 000 tests ont été distribués au Canada. Ils ont d’ailleurs permis de détecter cinq cas positifs, dont deux chez des personnes qui réalisaient un test de dépistage du VIH pour la première fois.
« Avec l’autotest, on rejoint des personnes qui n’ont pas forcément accès à une clinique de dépistage ou au système de santé comme les étudiant·e·s étranger·ère·s », ajoute Martine.
Elle souligne l’importance d’offrir plusieurs options de dépistage à la population canadienne, entre autres pour que les personnes qui ne se sont jamais fait dépister le fassent dès aujourd’hui.
Que fait-on si le résultat est positif?
Si l’autotest se fait (presque!) en claquant des doigts, les événements suivant un résultat positif sont quant à eux moins faciles à affronter.
« Le plus important, c’est la période après le résultat positif. C’est là que les organismes communautaires entrent en jeu. En 2022, recevoir un résultat positif, c’est pas la fin du monde, mais il faut savoir bien s’entourer, traverser chacune des étapes et être accompagné·e par un·e médecin », explique Ken, qui a lui-même reçu un résultat positif il y a plusieurs années.
Parmi les différentes étapes à franchir, on compte l’obtention de support psychologique, la consultation d’un·e médecin pour confirmer le résultat, la réception des soins et le début d’un traitement contre le VIH. On ne le dira jamais assez souvent : plus le VIH est détecté tôt, plus il est facile à traiter.
Et si le résultat est négatif?
Avant de se réjouir, il faut se demander si le test a été effectué suffisamment longtemps après l’exposition, soit pendant la période fenêtre. La majorité des gens auront un résultat fiable trois à six semaines après l’exposition, mais pour un petit nombre de personnes, la fenêtre sérologique peut atteindre douze semaines. Si on a des doutes que le test a peut-être été effectué trop tôt, il est important de repasser un second test pour valider le premier résultat.
Quoi qu’il en soit, Martine, Ken et Tanguy sont unanimes : il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour prévenir l’infection. L’obtention d’un résultat négatif peut être le bon moment pour évaluer différentes options préventives, comme la prise de la PrEP ou encore la PPE. Il y a plein d’infos sur les différentes méthodes de protection sur le site du DépistaFest, notre festival de dépistage des ITSS. Enfin, il est toujours possible de contacter un·e intervenant·e communautaire pour en apprendre davantage sur les différentes façons de prévenir le VIH.
Que ce soit parce que tu as eu une relation sexuelle non protégée ou encore parce que tu ne t’es jamais fait dépister pour le VIH, il est toujours temps de faire un test. Procure-t’en un en te rendant sur le site web de la recherche « J’agis pour savoir » ou prends un rendez-vous pour un dépistage dans l’une des cliniques partenaires du DépistaFest, ou en consultant cette carte des sites de dépistage VIH et ITSS au Québec.