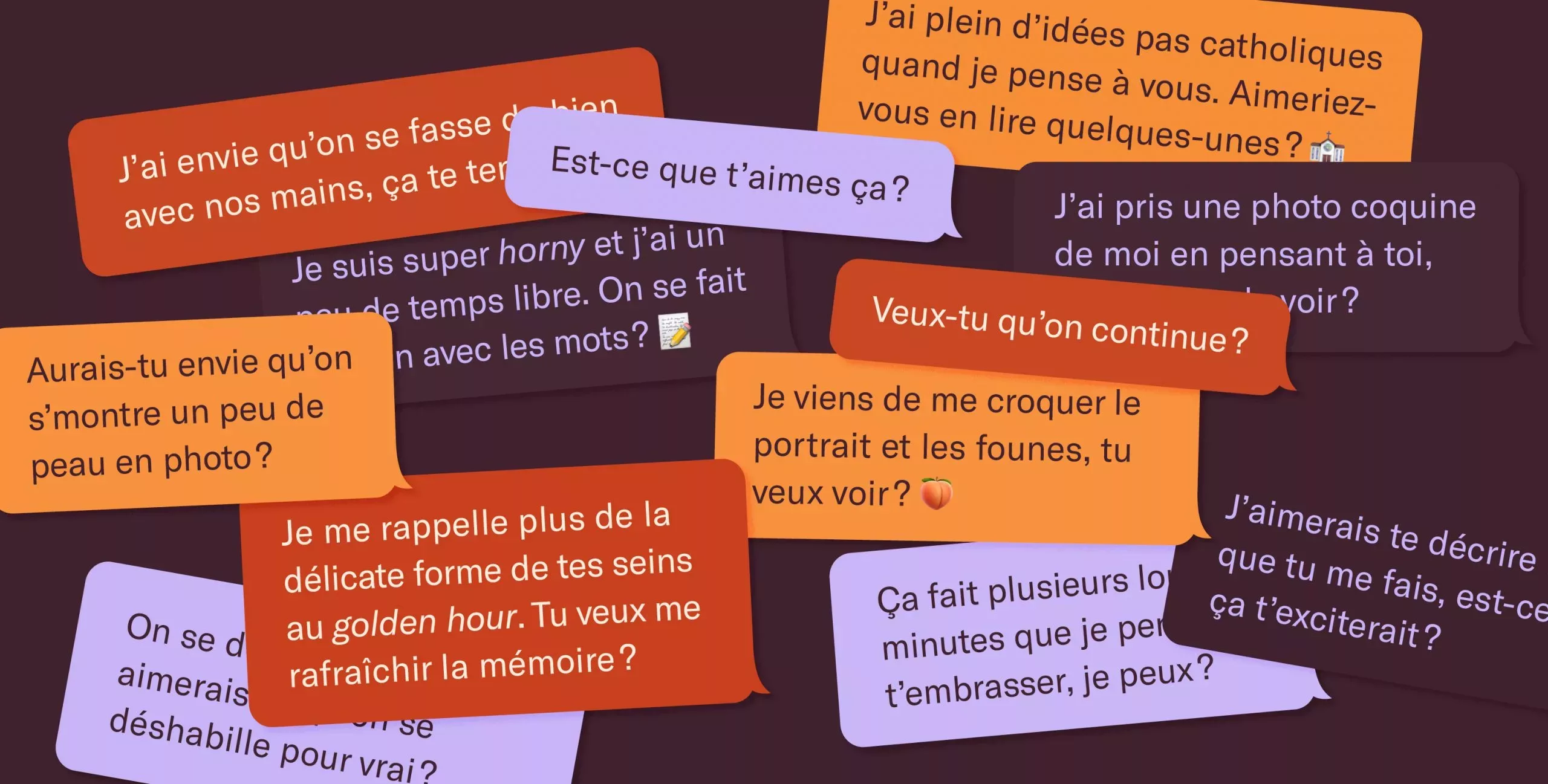Your cart is currently empty!
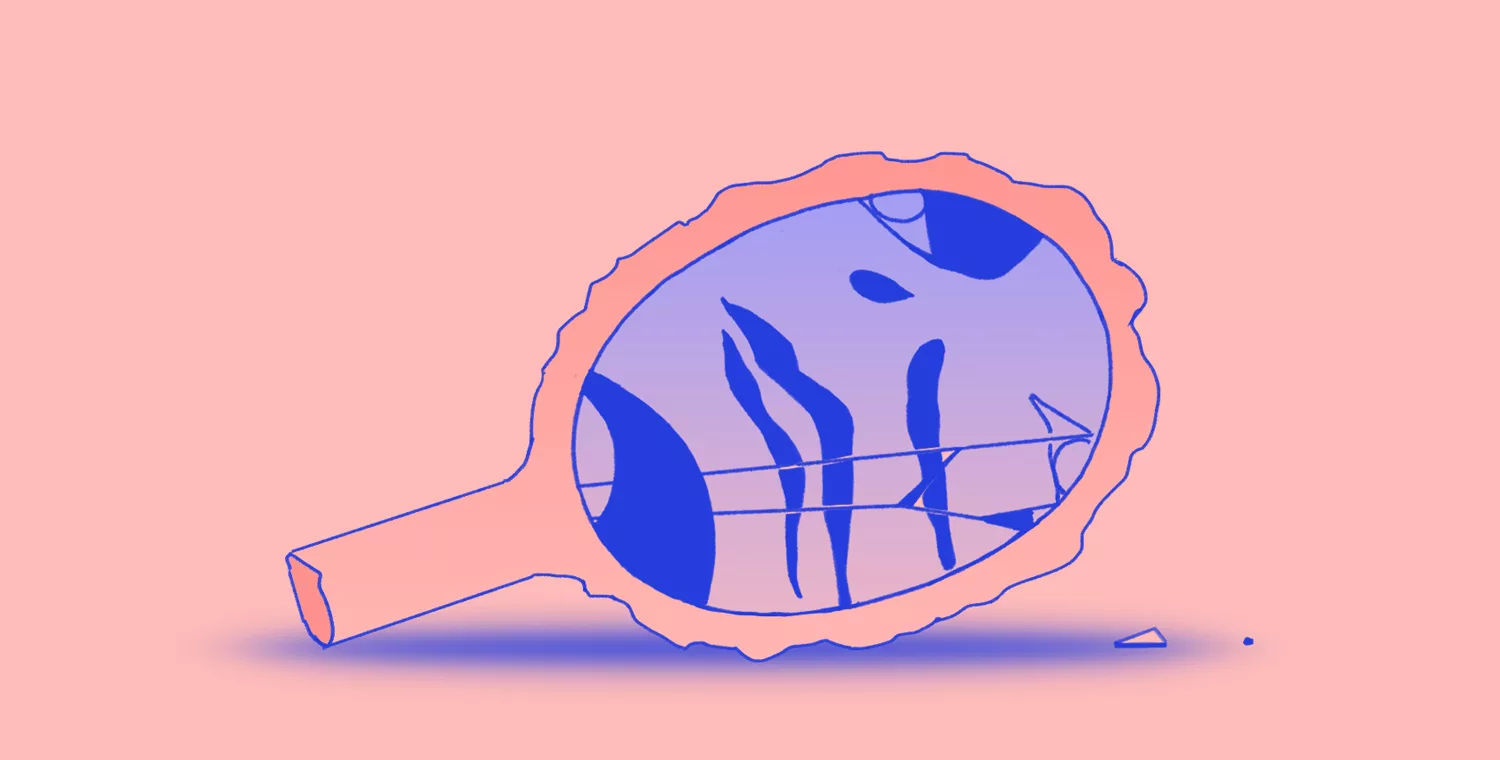
Vivre avec l’herpès

Cet article est présenté par Prelib.
Savais-tu que le test d’herpès ne fait pas partie du dépistage routinier offert par la majorité des cliniques de dépistage. Non? Pas de stress, on est là pour ça!
Je me suis justement donné comme but de déconstruire certaines idées préconçues rattachées à l’herpès, avec l’espoir de normaliser peu à peu le sujet. J’ai ainsi discuté avec trois personnes vivant avec l’herpès depuis quelques années afin de vous présenter leur point de vue.
« J’aimerais que les gens comprennent que c’est pas la fin du monde, et qu’il faut aussi prendre le temps d’écouter la personne. La personne qui a l’herpès, elle va s’informer, elle va finir par comprendre comment gérer ça. Il faut leur donner une voix, ce que la société ne fait juste pas. » – Théo*
L’herpès, c’est quoi?
L’herpès, c’est une infection transmissible sexuellement qui est définie comme étant chronique, c’est-à-dire qu’elle ne se guérit pas et qu’elle affecte les gens porteurs pour une grande majorité de leur vie. Il existe deux types d’herpès, tous deux causés par le Virus Herpès Simplex AKA le VHS (INSPQ, 2016) :
- Le VHS-1 : L’herpès de type 1 se manifeste souvent autour de la bouche (allô les feux sauvages!), mais peut également se transmettre aux organes génitaux.
- Le VHS-2 : L’herpès de type 2 se manifeste majoritairement au niveau de la région génitale et anale, et très rarement dans le visage.
Les deux types se transmettent de la même façon : par contact peau à peau avec une zone infectée, symptômes ou pas! (la majorité du temps lors de sexe oral et/ou génital/anal, et même lors de partage de jouets sexuels).
Bien comprendre les deux types d’herpès est une étape importante pour normaliser cette ITSS. En fait, ça va aider à déconstruire l’idée générale qu’avoir l’herpès génital, c’est la fin du monde et la pire maladie à se faire diagnostiquer, alors qu’un feu sauvage sur la bouche est no big deal. Pourtant, les deux proviennent précisément du même virus, et les symptômes sont ordinairement les mêmes!
Théo vit avec l’herpès de type 2 depuis maintenant près d’un an et exprime ressentir encore de la frustration quant à ce « double standard » :
« Des feux sauvages, c’est de l’herpès aussi, mais on dirait que les gens l’excusent. Par contre, si le tien est sur tes parties génitales, les gens ne l’excusent pas. »
Alors, pourquoi l’herpès génital a une telle réputation si on accorde si peu d’importance aux gens exhibant un feu sauvage sur la lèvre? Léa Séguin , diagnostiquée avec l’herpès de type 1 depuis aujourd’hui huit ans, a sa propre théorie : « On vit dans une culture qui est très sex-negative en général, donc si t’as contracté quelque chose à travers le sexe, c’est toujours pire que si tu l’as contracté à travers une activité qui n’était pas sexuelle. »
C’est (malheureusement) logique. La stigmatisation sociale et la honte liées au statut d’herpès génital sont habituellement de plus grande envergure que les symptômes eux-mêmes, et peuvent bien souvent engendrer des conséquences sur le bien-être psychologique et sexuel des personnes affectées (Scoular, 2002). À quel point le manque d’éducation à la sexualité a bien plus de répercussions qu’on le pense?
L’herpès, une affection collective
L’herpès génital demeure l’une des ITSS les plus communes et répandues globalement… Et ironiquement, l’une des plus méconnues. Qui sait combien de gens autour de nous sont affectés par l’herpès?
Théo a reçu la réponse à cette question lorsqu’il a commencé à parler de son diagnostic autour de lui. Non seulement sa mère lui a avoué vivre avec l’herpès depuis plusieurs décennies, mais de nombreuses personnes, ami·e·s et connaissances, lui ont confié qu’elles partageaient également cette réalité.
Surprenant? En fait, pas vraiment :
- Une étude effectuée par Statistique Canada en 2013 a recensé qu’environ 14 % des individus âgés entre 14 et 59 ans étaient porteur.se.s du VHS-2. Juste pour vous donner une idée, 14 %, c’est approximativement 2,9 millions de personnes : c’est pas mal!
- La prévalence du VHS-1, encore plus élevée, varie selon plusieurs recherches : on estime toutefois qu’entre 50 et 90 % de la population canadienne pourrait en être porteuse (Singh et al, 2003).
Alors, si tu pensais être seul·e, détrompe-toi! Le caractère tabou de l’herpès, constamment entretenu et stimulé par un mixte de désinformation et de jokes plates, amplifie malheureusement le silence autour des diverses expériences vécues. Combien de fois a-t-on entendu un commentaire du style : « Bah, ça pourrait être pire, tu pourrais avoir l’herpès! »?
Mentionnons également que 80 à 90 % des gens porteurs du virus ne développeront jamais de symptômes!
En outre, une majorité pourra vivre un seul épisode de lésions, puis ne plus développer de symptômes par la suite (ou très rarement).
C’est le cas de Théo, mais aussi de Leïla*, diagnostiquée il y a de cela trois ans. Après avoir vécu un premier épisode , les deux demeurent encore à ce jour asymptomatiques.
Leïla explique qu’avec son expérience de feux sauvages autour de la bouche, récurrents depuis son enfance, elle a appris à reconnaître les signes de son corps et même ce qui peut trigger certains symptômes, que ce soit au niveau de la bouche et/ou au niveau génital. Précisons toutefois qu’une absence de symptômes n’est pas toujours synonyme avec une absence de risques de transmission!
Léa, quant à elle, a dû gérer plusieurs épisodes au cours des premiers mois suivant son diagnostic, qui, avec le temps, ont fini par diminuer en termes d’intensité et de récurrence. Présentement en couple, Léa est également consciente des messages que son corps lui envoie et la communication entre elle et son partenaire se fait naturellement : dès qu’elle ressent la possibilité d’un risque (des picotements ou une sensation pas trop familière au niveau génital par exemple), les deux s’abstiennent d’avoir une relation sexuelle (ce qui ne dure habituellement pas plus d’une semaine).
Porter attention aux signaux de son corps ainsi qu’être conscient·e de ce qui se passe down there (y jeter un coup d’œil de temps en temps, faire des check-up réguliers), devient ainsi une nécessité pour la plupart des gens ayant déjà vécu des symptômes; d’ailleurs, ce devrait également l’être pour tout le monde, herpès ou pas! Je dis ça, je dis rien.
To tell or not to tell…
Le processus d’en parler (ou non) à ses partenaires sexuels et/ou romantiques évolue de façon bien différente d’une personne à l’autre. Même si le choix de divulguer son statut d’herpès génital demeure propre à chacun·e , c’est néanmoins une conversation qui est encouragée par beaucoup de spécialistes de la santé : aviser ton, ta ou tes partenaire·s sexu·s pourrait en effet réduire le risque de transmission de plus de 50 % (Schiffer, 2009).
Yes, la communication fait des miracles! Elle peut permettre de s’informer et d’adopter certains comportements (comme de se protéger lors d’épisodes de feux sauvages) qui feront en sorte que ta vie sexuelle sera aussi le fun qu’avant!
De son côté, Léa a toujours bien vécu le moment de divulgation à ses partenaires, et ce, depuis la nouvelle de son diagnostic. Lorsqu’elle considère se sentir safe émotionnellement avec une personne, et ce, toujours avant d’avoir une première relation sexuelle, elle aborde le sujet avec une certaine légèreté, en expliquant qu’elle a parfois des feux sauvages qui se retrouvent plutôt… en bas! Depuis, elle affirme n’avoir jamais vécu d’expériences négatives de ce côté.
Malheureusement, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Et pour toi qui s’est déjà fait ghoster ou rejeter : ton expérience est valide et au besoin, tu trouveras plusieurs ressources à la fin de l’article qui peuvent t’aider.
« Sur le plan légal, c’est pas obligatoire de le dire, mais je sens quand même un désir de le dire à la personne avant, pour qu’elle sache que je la respecte, que je lui donne la chance de dire non si elle veut, et que c’est un choix éclairé. » – Léa
Léa considère également que s’informer sur le sujet après avoir reçu un diagnostic peut être très rassurant et même te donner des munitions contre le manque d’éducation de certaines personnes : « Disons que quelqu’un·e te shoot quelque chose, tu peux le rationaliser, le banaliser même avec les connaissances que tu aurais accumulées là-dessus. », explique-t-elle, avant d’ajouter : « Knowledge is power! »
Il n’existe aucune façon parfaite de divulguer son statut à son, sa ou ses partenaire·s. Fais-toi confiance, et au besoin, tente de t’inspirer de certains concepts-clés :
- S’informer. Léa l’a dit : « Knowledge is power! »
- Si possible, maintenir la conversation casual, sans l’aborder de façon alarmiste ou dramatique (ce ne l’est pas!).
- Essayer de s’imaginer dans la situation inverse. Comment aurais-tu aimé qu’on t’en parle?
- Si la personne ne te respecte pas là-dedans, tant pis pour elle! Tu lui enverras le lien de cet article par texto après. Anyways, tu mérites d’avoir des relations sexu avec des personnes qui te respectent et qui t’apprécient pour qui tu es.
- Souviens-toi : l’herpès ne définit pas la personne que tu es au même titre que n’importe quelle autre maladie chronique telle que l’asthme ou le diabète!
Tu peux aussi aller jeter un coup d’œil à notre article de do’s and don’t quand vient le temps de dévoiler une ITSS.
Alors, pourquoi ne dépiste-t-on pas l’herpès?
Les cliniques de dépistage n’incluent pas l’herpès dans leur liste d’ITSS de base à dépister. En fait, il est même non recommandé de faire une demande de dépistage du VHS lorsqu’on ne présente aucun symptôme!
- Contrairement à plusieurs autres ITSS, l’herpès génital ne présente majoritairement aucun danger pour la santé générale à long terme.
Tu crois reconnaître quelques symptômes (picotements, rougeurs, brûlements, lésions) après quelques ébats entre les draps? À la suite d’une relation sexu, la personne t’appelle pour te prévenir qu’elle vient de recevoir un diagnostic d’herpès?
- Avant tout, va voir un·e médecin qui pourra te guider vers une démarche appropriée. Par exemple, tu peux contacter la clinique Quorum ou l’Actuel, nos partenaires pour le DépistaFest.
Si tu cherches de l’information et/ou du soutien, voici quelques plateformes et ressources disponibles sur Internet :
- Le projet Info-Herpès
- Le groupe d’entraide et de soutien herpès génital de Montréal
- Le balado Life with herpes
- L’instagram @my_boyfriend_has_herpes
- N’hésite pas à aller chercher du counselling auprès de sexologues et de psychologues.
*Les prénoms ont été modifiés par souci d’anonymat
-
Freeman, E., Weiss, H., Glynn, J., Cross, P., Whitworth, J., Hayes, R. (2006). Herpes simplex virus 2 infection increases HIV acquisition in men and women: systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. AIDS, 20(1). doi: 10.1097/01.aids.0000198081.09337.a7
Gouvernement du Québec. Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2019). Cadre d’interprétation et de gestion des signalements en santé publique. Récupéré de https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-268-02W.pdf
INSPQ. (2016). Info-Herpès. [Brochure]. (s. l. : n. é.). Récupéré de https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/itss/brochure_info-herpes_2016-pvsq.pdf
Psychomédia. (2020). Définition : Test sérologique. Dans Psychologie et santé. Récupéré de http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/test-serologique
Rotterman, M., A. Langlois, K., Severini, A., et Totten, S. (2013). Prevalence of Chlamydia trachomatis and herpes simplex virus type 2: Results from the 2009 to 2011 Canadian Health Measures Survey. Statistics Canada, 24(4). Récupéré de https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2013004/article/11777-eng.htm
Scoular, A. (2002). Using the evidence base on genital herpes: optimising the use of diagnostic tests and information provision. Sexually Transmitted Infection, 78(3). 160-65. https://doi.org/10.1136/sti.78.3.160
Schiffer, J., Corey, L. (2009). New Concepts in Understanding Genital Herpes. Current Infectious Disease Report, 11(6). 457-464. https://doi.org/10.1007/s11908-009-0066-7
Singh, A., Romanowski, B., Wong, T., Gourishankar, S., Myziuk, L., Fenton, J., et Preiksaitis, J. (2005). Herpes Simplex Virus Seroprevalence and Risk Factors in 2 Canadian Sexually Transmitted Disease Clinics. Sexually Transmitted Disease , 32(2). 95-100. https://doi.org/10.1097/01.olq.0000151415.78210.85
Steben, M., Landry G., Cruz de Menedes, R. (2016). La sérologie du virus Herpès Simplex : trucs, attrapes et tromperies. Le Médecin du Québec, 51(10). 4-31. Récupéré de : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2462_serologie_herpes_simplex.pdf
World Health Organization. (2020). Herpes simplex virus. Récupéré de https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus