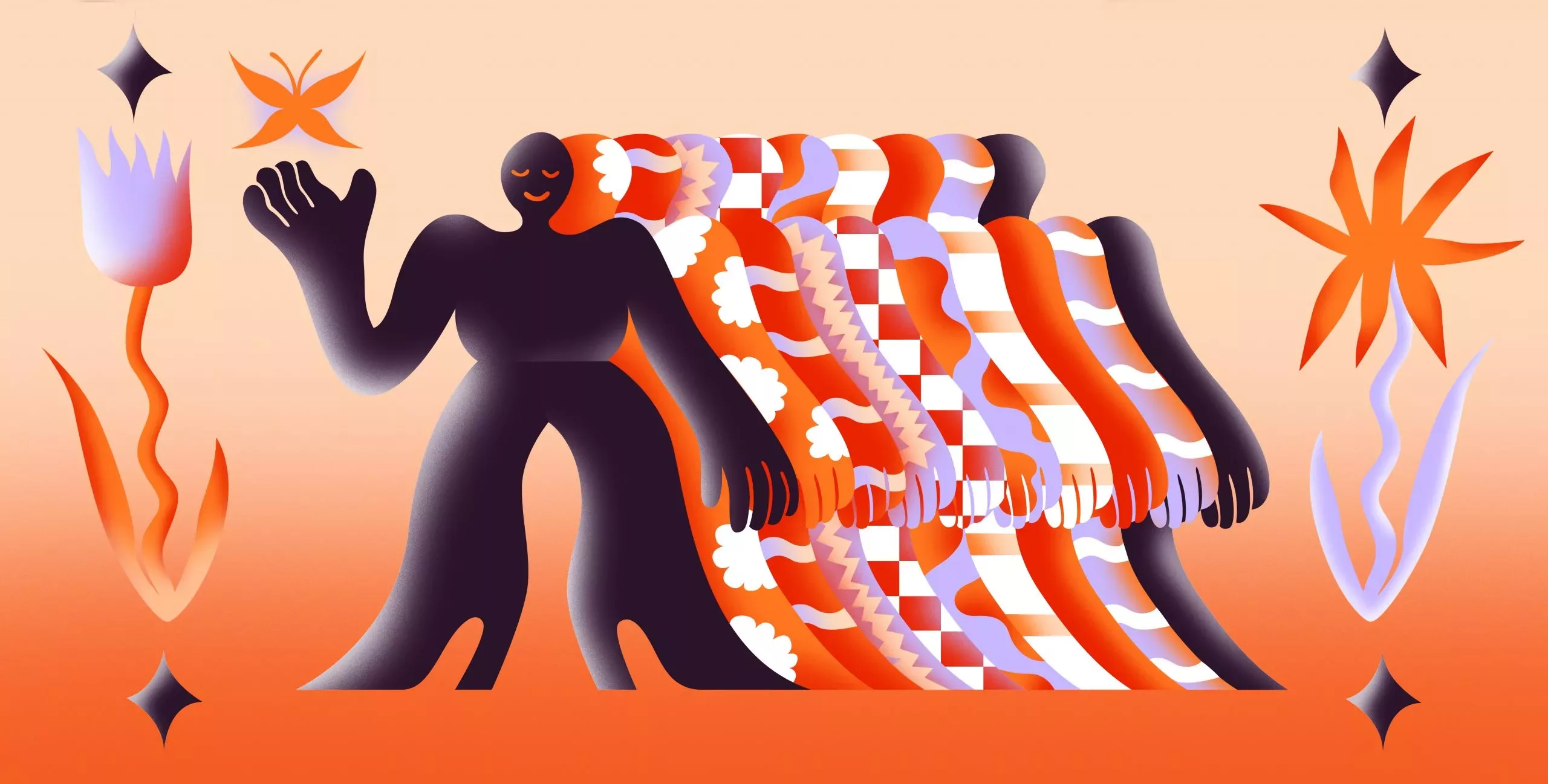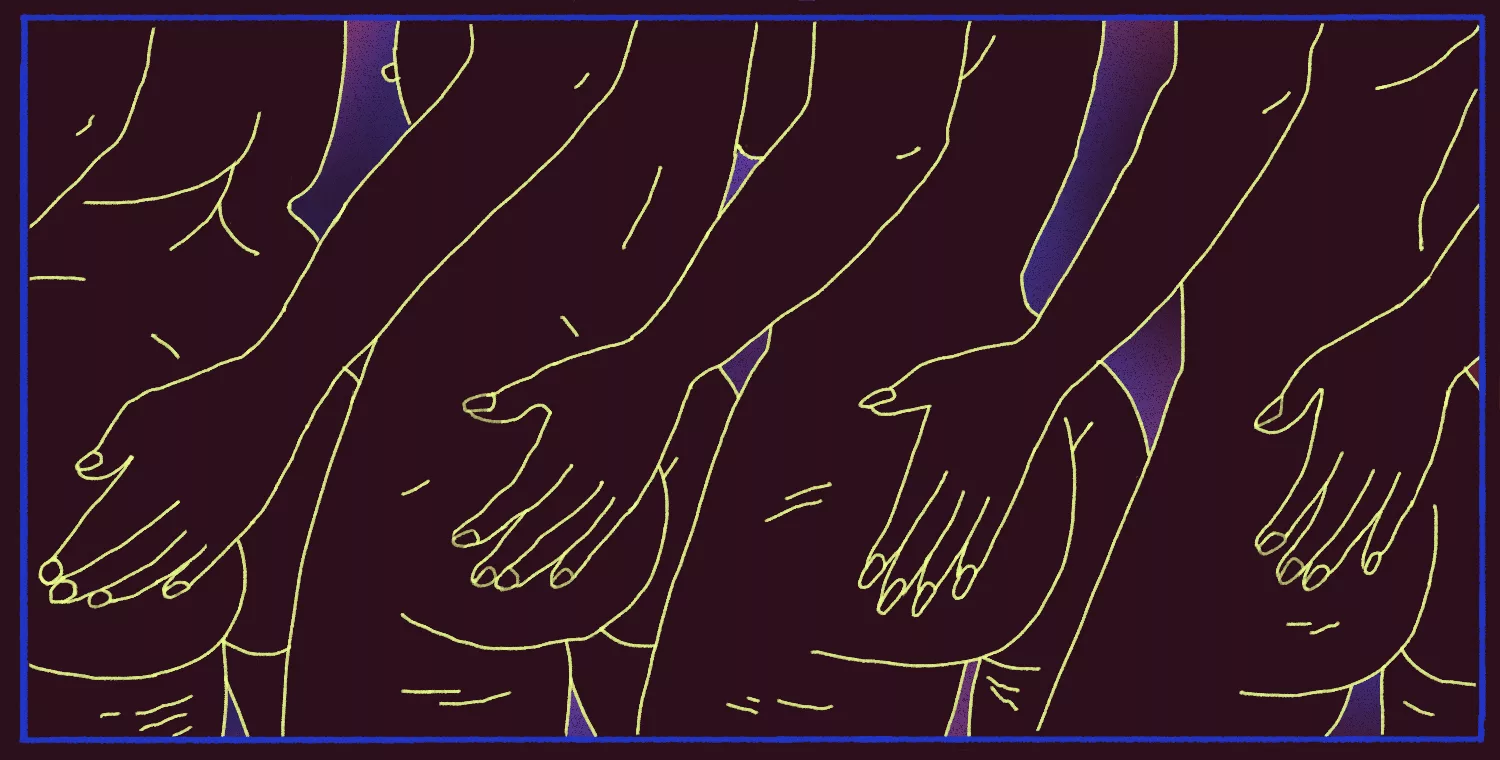Your cart is currently empty!
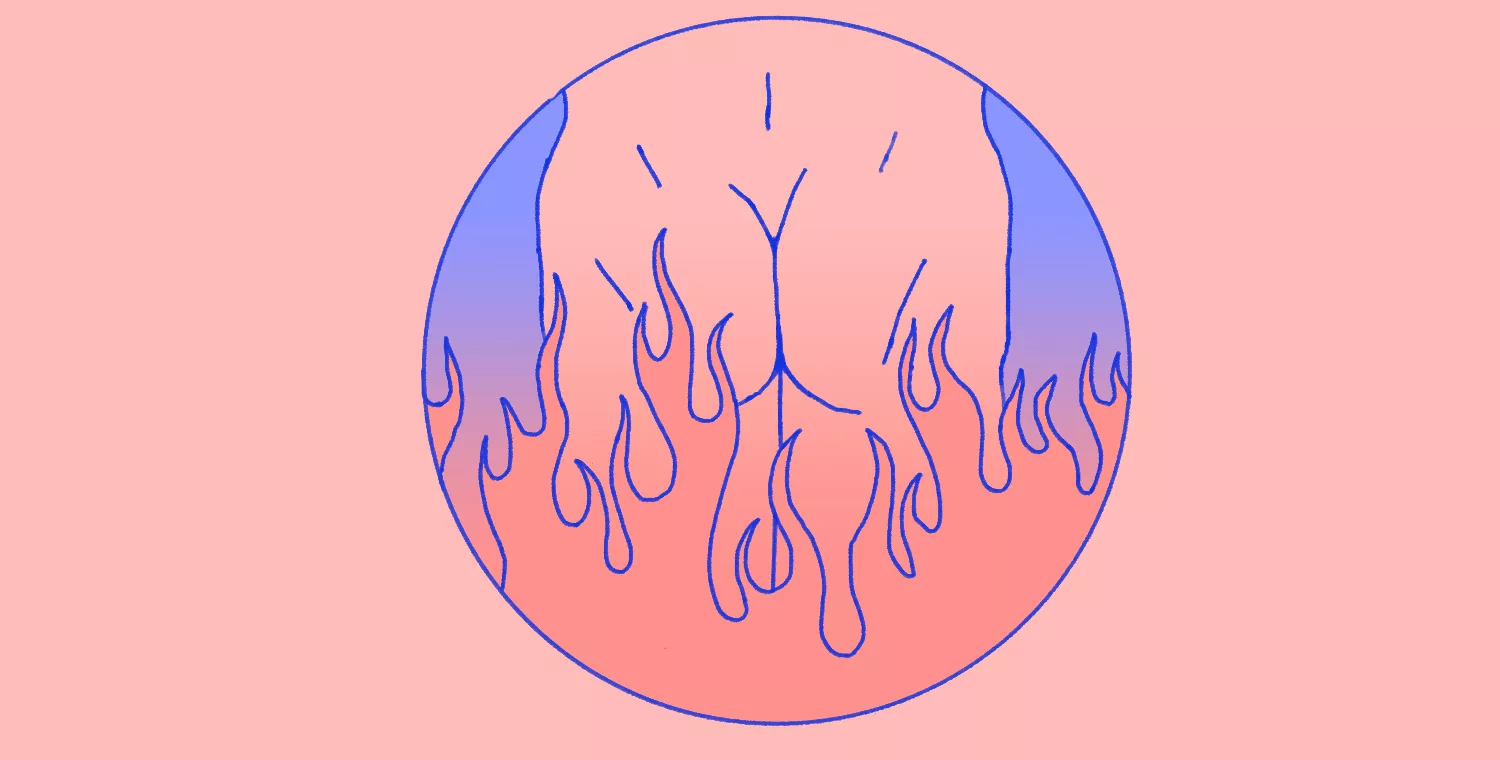
La syphilis, le poignard et l’Esprit saint

Cet article est présenté par Prelib.
« Tu devrais en jaser avec Simon. Lui aussi, il a pogné une syphilis. »
Ça a commencé comme ça. Je le connaissais pour l’avoir croisé à quelques occasions, mais pas au point de lui écrire un jour pour l’inviter candidement à jaser de syphilis dans un parc. Sauf que j’avais envie de me sentir un peu moins seul avec cette histoire, et il a accepté de me partager la sienne pour le Club Sexu.
Alors, on s’est donné rendez-vous quelque part et j’ai vite compris que le gazon est pas toujours plus doux chez le voisin.
La syphilis : une légende urbaine?
Dès le début de notre conversation, je comprends que ses attentes sont hautes et qu’il a hâte d’entendre MON histoire : « J’ai pas pogné une syphilis dans une orgie sur la Lune, t’sais! Tu risques d’être déçu », que je lui dis.
Simon, c’est le genre de gars relaxe dont l’humeur ne semble jamais trop changer. Il peut te raconter tous les détails intimes et croustillants de sa vie sur le même ton, sans donner l’impression que ça le gêne. Parler de smoothies ou de fissures anales, c’est du pareil au même pour lui. J’adore ça.
« Les professionnel·le·s de la santé disent souvent que la syphilis est revenue en force ces dernières années dans la communauté gaie, et pourtant, tu es la première personne qui me confie en avoir eu une », me dit-il.
Je fige un instant pour chercher dans mes souvenirs des amis qui m’auraient raconté en avoir chopé une, mais c’est le néant. Je croise au passage quelques histoires de gonorrhées et de chlamydias (qui sont presque monnaie courante ), mais aucune de syphilis. Ça explique sans doute pourquoi je me sentais un peu isolé dans tout ça. On discute de cet étrange tabou sans jamais vraiment y trouver d’explication.
« Ce que je retiens de mes cours d’histoire, c’est l’impression que tous les grands artistes de ce monde sont morts d’une syphilis », propose-t-il en guise de semi-explication.
Je lui explique que, de mon côté au secondaire, j’avais dû faire une présentation orale sur la syphilis. Tout ce que mon cerveau avait retenu de ce projet, malheureusement, c’était des grosses pustules, des lésions au cerveau, de la pénicilline et le mot « mort ». Disons que l’objectif pédagogique n’avait pas été atteint.
Simon se lance alors dans son récit. Il me raconte qu’après une rupture, il a traversé une période de quatre ans d’émancipation sexuelle (qu’il appelle affectueusement sa hoe phase). Durant ce temps, il dit avoir été dépisté aux trois mois et avoir contracté très peu d’infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) malgré les nombreux partenaires qui ont croisé sa route (ou plutôt son entrejambe).
Jusqu’à ce qu’il arrive au certain weekend de la fête du Travail, durant lequel il n’a clairement pas chômé : « J’ai été particulièrement charrue », résume-t-il, expliquant avoir eu des comportements à risque et que ses souvenirs sont plutôt flous.
« Pour ma repentance, au lieu d’aller à l’église, je suis allé à la clinique, environ deux semaines plus tard », dit-il le sourire en coin.
90 jours de douleurs
Et c’est là que son enfer a débuté. De toute évidence, la période fenêtre ne s’était pas écoulée, l’infection n’était pas encore détectable et ses résultats négatifs l’ont mené sur une fausse piste… Pendant plusieurs mois!
À partir du moment où Simon reçoit ses résultats, une enfilade de symptômes particulièrement douloureux se font ressentir et s’étireront jusqu’en décembre. Ça commence avec des diarrhées intenses, puis ça se transforme en douleurs anales qui durent des semaines et des semaines.
« Quand j’allais faire un numéro deux, j’avais l’impression qu’on me rentrait un poignard dans les fesses. Et ça continuait après pendant plusieurs heures. » On comprend vite par où s’est faite la transmission, disons.
Simon me dit que pendant ces 90 jours de douleurs, il est allé à l’urgence trois fois. On lui a notamment prescrit un antibiotique contre les infections urinaires et une crème contre l’herpès. Je suis stupéfait : « Aucun·e médecin n’a eu l’idée de faire ne serait-ce qu’un petit test pour une ITSS? » Non, zéro, niet, pantoute.
Ce n’est qu’en décembre qu’il remarque des taches rouges sur son abdomen qui se propagent rapidement sur son corps en moins de quatre jours. Ses recherches sur Google ne le mènent pas vers des pistes rassurantes : « Il y avait deux options : soit c’était une maladie de la peau qui avait un nom du genre « médaillon de quelque chose », soit j’étais en phase 1 d’être séropositif », me dit-il avec des yeux qui n’entendent pas à rire.
Convaincu d’avoir le VIH, il obtient heureusement un rendez-vous d’urgence le lendemain dans une clinique spécialisée en ITSS. La médecin (et un test de VIH rapide ) éliminent aussitôt son hypothèse. Elle analyse attentivement son anus, quitte le local, revient avec une médecin plus expérimentée et deux étudiant·e·s, puis leur pointe le chancre (typique de la syphilis) en disant simplement : « Ça, c’est ce que vous devez trouver. »
Deux jours plus tard, un test sanguin permet de confirmer le diagnostic et Simon reçoit une injection de pénicilline dans chaque fesse. « C’est des longues piqûres, hein? », lui dis-je. « Quand ça fait trois mois que tu as l’impression d’avoir un poignard qui te sort du cul… C’est très court! », me répond-t-il. Il n’a pas tort. Moins de deux semaines plus tard, la douleur et les taches rouges étaient 100 % disparues.
Pis toi ton poignard, il était où?
C’est alors que Simon me demande quelle est MON histoire. Je me sens un peu mal de lui dire qu’elle est à des lunes de la sienne. Je lui résume donc rapidement, comme on arrache un diachylon.
« C’était mon dépistage que je fais tous les trois mois, j’ai eu un résultat positif à la syphilis, je n’avais aucun symptôme ni aucune douleur et on m’a traité le lendemain. » Son regard insistant me fait comprendre qu’il attend une suite. J’enchaîne donc : « Le lendemain de mon traitement, la clinique m’a rappelé pour me dire que j’avais aussi un résultat positif de chlamydia. »
Sa mâchoire tombe. Mon histoire est plate, mais j’ai au moins réussi mon punch.
Simon me demande si j’avais eu des comportements à risque. Pour moi, n’importe quel rapport sexuel constitue un risque, mais je comprends qu’il parle de pénétration sans protection. L’hypocondriaque non diagnostiqué que je suis lui répond NON d’une manière assez catégorique.
Il faut dire que la syphilis se contracte par tout contact sexuel, comme la gonorrhée et la chlamydia, donc pas besoin de prendre de risques supplémentaires pour courir la chance de la gagner!
Je lui raconte aussi que j’avais alors contacté mes partenaires sexuels des mois précédents pour les informer. Chacun d’eux est allé se faire dépister et m’a ensuite dit avoir obtenu un résultat négatif : « C’est comme si j’avais reçu une syphilis de l’Esprit saint! », lui dis-je à la fois outré et découragé.
À ce moment, un ballon de soccer roule près de nous. L’enfant à qui il appartient court pour le récupérer. « Fais attention à la syph’! », lui chuchote Simon à la blague avec une voix un peu creepy. Le petit garçon n’entend rien, heureusement. On rit en le regardant repartir au loin, jusqu’à ce qu’il s’enfarge et se plante tête première.
« Si tu me demandes ce que je préfère entre me péter les dents ou attraper une syphilis une deuxième fois, j’avoue que j’hésite », me dit-il.
Je regarde l’enfant qui pleure et qui hurle, la bouche en sang. Le choix m’apparaît alors évident. Je choisirais la syphilis; ça se règle bien plus vite.
* Prénom fictif, pour protéger son anonymat
-
Broeckaert, L. et Challacombe, L. (2015). Dépistage rapide du VIH au point de service : Un examen des données probantes. CATIE. https://www.catie.ca/fr/pdm/printemps-2015/depistage-rapide-vih-point-service-examen-donnees-probantes
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2017). Syphilis – CDC Fact Sheet. https://www.cdc.gov/std/syphilis/stdfact-syphilis.htm
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Syphilis – CDC Fact Sheet (Detailed). https://www.cdc.gov/std/syphilis/stdfact-syphilis-detailed.htm
Choudhri, Y., Miller, J., Sandhu, J. Leon, A. et Aho, J. (2018, 1er février). La syphilis de 2010 à 2015. Agence de santé publique du Canada (ASPC). https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2018-44/numero-2-1-fevrier-2018/article-2-syphilis-2010-2015.html
Clinique médicale l’Actuel. (s.d.). Périodes d’incubation des ITSS – ITS – IST – MTS. https://cliniquelactuel.com/Periode_incubation_ITS_IST_MTS_ITSS
Defay, F. (2018, 23 février). Relevé des maladies transmissibles au Canada (RMTC) sur les ITSS. INSPQ. https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/releve-des-maladies-transmissibles-au-canada-rmtc-sur-les-itss
Gouvernement du Canada. (2021, 29 janvier). Syphilis. https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/syphilis.html
Gouvernement du Québec. (2016, avril). Guide québécois de dépistage. Infections transmissibles sexuellement et par le sang. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/formation/itss/2-guidequebecoisdepistageitss.pdf
Morris, S.D. (2020, décembre). Syphilis. Le manuel Merck Version pour professionnels de la santé. https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/maladies-infectieuses/maladies-sexuellement-transmissibles/syphilis
North Dakota Department of Health. (2018, juillet). Time Periods of Interest. HIV, STDs Viral Hepatitis. https://www.ndhealth.gov/hiv/Docs/CTR/TimePeriodsReference_HIVSTDsHep.pdf
SmartSexResource. (2016). Tolstoy May Be History but Syphilis is Not. https://syphistory.ca/
Tampa, M., Sarbu, I., Matei, C., Benea, V. et Georgescu, S.R. (2014). Brief History of Syphilis. J Med Life, 7(1), 4-10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956094/